L'église de Cour-Cheverny : une église de monastère à l'origine ?
Qui a construit l’église
Saint-Aignan (1) de Cour-Cheverny, à quelle époque et pour quel usage ? La
Grenouille, férue d’histoire locale, s’est posé la question, attirée par le
caractère atypique de cet édifice religieux.
 |
| Cliquez sur l'image pour l'agrandir |
Nous savons par les
historiens que cette église dédiée à Saint-Aignan a été construite au XIe ou
XIIe s. au plus tard (puis transformée par la suite), mais par qui et pour quel
usage ? Était-elle, comme certaines églises de villages voisins, une église
incorporée à un monastère ? S’il ne reste aucune trace aujourd’hui de l’existence
d’un monastère, comme à Chailles par exemple, la structure de l’édifice
associée aux données fournies par les historiens peuvent n ous donner certaines
indications.
1) La chronologie et
l’histoire de l’implantation des moines de l’abbaye de Bourgmoyen à
Cour-Cheverny.
C’est aux XIe et XIIe
siècles, après les invasions normandes, que se situe le plus grand
développement de construction des églises de notre pays. À cette époque, les
donations aux abbayes, qui sont nombreuses, (fondées pour la plupart depuis les
VIIe et VIIIe s.) permettent la construction de beaucoup des églises qui
existent encore actuellement, avec leurs transformations au cours des siècles
suivants.
 |
| La travée centrale, assez étroite (3,65 m entre les piliers) |
L’église de Cour-Cheverny
figure dès 1145 parmi les possessions de l’Abbaye de Bourgmoyen de Blois. Plus
exactement, il s’agit d’un prieuré - cure dépendant des chanoines réguliers de
cette abbaye appartenant à l’ordre de Saint-Augustin [mentionné dans
différentes Bulles papales (cartulage de Bourgmoyen) : Curia juxta Chaverneium,
vel Sigalonia (2), (en 1254 - Bulle du pape Alexandre IV – également Bulle
d’Eugène III en 1145)].
L’abbaye de Bourgmoyen,
appellée aussi monastère de Sainte-Marie appartenait alors à l’archevêché de
Chartres (celui de Blois n’existait pas encore). Elle fut fondée en 696 par des
chanoines séculiers qui furent remplacés par des réguliers (3) en 1123.
Anciennement, un
prieuré-cure était une cure dépendant d’un monastère de chanoines réguliers.
Les chanoines acceptaient les charges pastorales et de petits groupes de trois
ou quatre formaient des communautés dans les paroisses. Plutôt que cure,
leur résidence s’appelait alors prieuré.
Les prieurés étaient dotés
d’églises construites et entretenues par l’abbaye-mère. (dans notre région, les
églises construites par l’abbaye de Bourgmoyen sont celles de Chailles,
Cheverny, Cour-Cheverny, Huisseau et Les Montils). La construction de l’église
correspond donc à l’époque où les moines réguliers de Saint-Augustin
s’installèrent à Cour-Cheverny.
Ces différents éléments
historiques sont donc susceptibles d’étayer la thèse selon laquelle l’église de
Cour-Cheverny aurait fait partie d’un monastère. Malheureusement, nous ne
retrouvons aucune trace à notre époque de l’existence d’un tel monastère
(toutefois l’existence de murs anciens datant du XIIe ou XIIIe s. a été
révélée récemment lors des travaux de rénovation du restaurant des Trois
Marchands, voisin de l’église).
Et que dire des autres
églises ? Sauf à Chailles où nous savons que l’église était adossée à son
monastère, la preuve est rendue difficile car il ne reste pas, pour ces églises,
suffisamment d’éléments caractéristiques architecturaux de l’époque de la
construction primitive (quoique la question peut se poser pour l’église de
Cheverny où il existait aussi un prieuré-cure qui est également mentionné dans
des Bulles papales du XIIe s.).
 |
| L'église initiale de Cour-Cheverny, construite au XIIe siècle |
2) L’argument architectural
Pour l’église de
Cour-Cheverny, la situation apparaît différente, sur le plan architectural,
l’édifice comportant des éléments architecturaux atypiques qui laissent à
penser que c’était à l’origine une église de monastère.
Dans leurs ouvrages
consacrés au Loir-et- Cher, et en particulier au canton de Contres, les
historiens locaux, le chanoine Rémi Porcher et le docteur Frédéric Lesueur, ont
décrit l’église Saint-Aignan de Cour-Cheverny. Dans les pages consacrées à cet
édifice, ils décrivent les transformations et agrandissements du bâtiment au
cours des siècles (notamment aux XVIe et XVIIe s.) ainsi que les parties
primitives encore visibles:
Le docteur Lesueur écrit
ainsi, concernant les parties anciennes : « ...La nef avait primitivement
des arcades étroites... retombant sur des piles carrées : il en subsiste une à
gauche et trois à droite. Ces arcades romanes étaient surmontées d’une corniche
coupée par des corbeaux sculptés, qui supportent des pilastres. Le vaisseau
était éclairé directement par des fenêtres encore visibles dans le comble...
Les murs du bas - côté sud doivent remonter au XIIe siècle » (fenêtre romane)
».
 |
| La travée originelle, à droite de la nef centrale mesurait 3,50 m entre ses piliers |
Il
poursuit en évoquant les deux portails du XIIe s. et décrit les transformations
effectuées aux XVIe et XVIIe s. qui ont donné à l’église son aspect actuel,
bien différent de celui d’origine. Une partie des arcades primitives a été
élargie, la nef centrale reçut des voûtes d’ogives placées beaucoup plus bas
(dont une clef porte la date de 1609), les trois dernières travées du bas-côté sud ont été transformées et surtout un bas-côté nord a été
construit en miroir (qui fait ressortir l’étroitesse des deux autres nefs). À
l’extérieur, le petit clocher à bulbe a été ajouté au XVIIe s.
En ce qui concerne plus particulièrement
l’existence probable d’un monastère, Rémi Porcher, pour sa part, écrit «...
l’une et l’autre de ces nefs (NDRL : la nef centrale et « le bas côté à
droite ») sont très étroites, ce qui rend le choeur, qui termine cette nef
du milieu, un des plus exigü et des plus incommode que l’on puisse imaginer
pour une église paroissiale. Aussi la dimension attribuée à ces deux nefs
donne-t-elle lieu de soupçonner que, primitivement, cet édifice n’avait pas été
destiné à servir d’église paroissiale, mais devait être un monastère... Les
églises construites pour cette destination, même les plus vastes, sont toujours
plus étroites, quant aux nefs... On pourrait donc, avec assez de raisons,
penser que le local occupé aujourd’hui par l’église paroissiale de
Cour-Cheverny et de son presbytère, l’était autrefois par une maison
religieuse, dont la suppression remonte à des temps très reculés... La
population du bourg de Cour s’étant accrue, on a ajouté à la gauche de la nef
du milieu, un autre bas-côté qui, à lui tout seul, est plus large que cette nef
et l’autre bas côté pris ensemble...».
La thèse de Rémy Porcher apparaît
intéressante et à même de nous convaincre : n’était-il pas en effet bien
placé, étant lui-même un chanoine et connaissant parfaitement les spécificités
architecturales des églises de monastères pour remarquer que celle de
Cour-Cheverny était différente des autres pour les motifs qu’il indique ?
Le Héron - La Grenouille n°35 - Avril 2017
(1) En 451, Saint-Aignan était évêque
d’Orléans. Selon la tradition, il arrêta les Huns qui s’apprêtaient à envahir
la ville grâce à ses prières et au soutien armé des troupes d’Aetius (dernier
grand général romain en Gaule). Les Huns quittèrent alors la cité sans la
dévaster. De nombreuses localités et églises portent son nom en France, car il
fut considéré à l’époque comme un sauveur.
(2) Sigalonia = Sologne
(3) Les chanoines réguliers vivaient
généralement par groupes de trois ou quatre et acceptaient les charges pastorales
(ils sortaient de leur monastère).
Sources :
- Rémy Porcher : Petites monographies
des communes du Loir et Cher (Contres) Archives départementales G/F 61.
- Docteur Frédéric Lesueur : Les églises
de Loir-et-Cher. Archives départementales.
- Site internet « Les clochers de France
».
- Guillaume Doyen : Histoire de la ville
de Chartres... (1786).
 |
| A gauche : l'église Saint-Aignan de Cour-Cheverny à l'époque de sa construction (XIIe s.) A droite : l'église après la construction de son extension (XVIe et XVIIe s.) et de ses aménagements |
 |
L’église de Cour-Cheverny dans sa version actuelle.
Les
éléments ajoutés aux XVIe-XVIIe s.
sont représentés de couleur orange.
|
 |
| Vue arrière de l'église Saint-Aignan sur une carte postale ancienne |

 |
Combles actuels au-dessus du choeur.
Le plafond
construit vers le XVIe ou XVIIe siècle
au-dessus de la nef, constitue le sol
des combles.
|
Vous pouvez découvrir d'autres photos

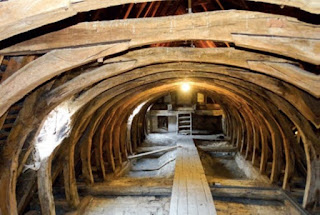







Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Merci de nous donner votre avis sur cet article, de nous transmettre un complément d'information ou de nous suggérer une correction à y apporter