Article n°1 - La Grenouille n°50 - janvier 2021
Nous poursuivons l’histoire de La Lyre de Cour-Cheverny/Cheverny, créée en 1890. Les conditions sanitaires exceptionnelles que nous avons dû tous observer en 2020 n’ont pas permis à La Lyre de fêter, comme elle le souhaitait, ses 130 ans d’existence.
La notion d’unité dans les sociétés musicales créées à la fin du XIXe siècle passait par trois éléments :
- le port d’une tenue, non comme
une référence militaire car il s’agit de fanfares civiles, mais dans un
objectif de mixité sociale. Les musiciens proviennent de tous horizons sociaux,
des disparités que l’uniforme a pour rôle de lisser ;
- la réalisation d’une bannière,
financée grâce à une souscription, et offerte à La Lyre par les membres
honoraires en 1925. Le premier porte-bannière était M. Sausset. Depuis 60 ans,
nous avons recensé les porte-bannières suivants : Raymond Puichaffray, Raymond Jouanneau,
André Béssé, Jean-Claude Mathon. Michel Thomas est le porte-bannière actuel
depuis 1993. Le porte-bannière défile fièrement en tête de la société musicale,
portant haut les couleurs de La Lyre. La remise d’une nouvelle bannière eut
lieu pour la cérémonie du centenaire, en présence de la Garde républicaine.
Elle permit d’associer les communes de Cheverny et Cour-Cheverny ;
- la création d’un hymne. L’hymne
« Cour- Cheverny » a été écrit par Georges Berrué vers 1940, marche que La Lyre
interprète toujours lors de ses sorties.
Ces générations d’hommes et de
femmes passionnés de musique contribuent à faire de La Lyre de
Cheverny/Cour-Cheverny une Société musicale que nous apprécions lors de toutes
les manifestations et concerts courchois et chevernois, comme hors de nos communes.
Espérons que des temps meilleurs permettront de les entendre à nouveau rapidement,
pour le plaisir de tous.
 |
| La remise d'une nouvelle bannière eut lieu pour la cérémonie du centenaire (1990), en présence de la Garde républicaine. Elle permit d'associer les commune de Cheverny et Cour-Cheverny |
Une sélection sévère
La Lyre de
Cheverny/Cour-Cheverny, ce sont des hommes et des femmes, passionnés de musique.
Ils ont commencé, très jeunes en général, à jouer de la musique, par tradition familiale
souvent, car fortement incités par les parents ou les grands-parents, mais
aussi par choix, parce qu’ils souhaitaient simplement pratiquer un instrument.
Chacun sait que les premières années, l’apprentissage est, pour certains,
plutôt fastidieux, voire rébarbatif : car, avant de jouer de l’instrument rêvé,
il faut apprendre le solfège…! Et là, le courage, voire la motivation, peuvent
parfois manquer… Ce n’est qu’après plusieurs années de solfège que
l’apprentissage de l’instrument commence.
Un règlement strict
La Lyre avait prévu dans ses
statuts, dès janvier 1890, les conditions d’admission des jeunes et la
formation musicale qui était assurée par les musiciens eux-mêmes. Il était précisé,
en particulier, « les conditions d’admission
pour les étrangers : le Conseil à l’unanimité refuse d’admettre dans la société
des élèves venant d’autres communes. Exception est faite pour les étrangers qui
connaîtraient la musique et auraient déjà joué d’un instrument, à moins
toutefois qu’ils ne se fixent définitivement dans le pays. Il sera urgent qu’ils
soient électeurs ou qu’ils produisent leur casier judiciaire conformément à
l’article 26 du règlement ».
L’admission et les inscriptions
de nouveaux élèves sont reçues toute l’année, mais les élèves inscrits après le
1er janvier ne peuvent prendre part aux cours qu’à partir du 1er novembre
qui suit les inscriptions. En juillet 1893 : « La sélection des jeunes pour jouer est faite par le chef, M.
Bouton, avec le sous-chef, M. Bailly, nouvellement établi au pays et ancien
musicien de l’armée. Ils donnent des cours sur les premiers éléments de la musique
».
Pour certains élèves, il ne leur
est reconnu aucune aptitude pour faire d’eux des musiciens, même bien
ordinaires. « En conséquence le Conseil
décide que le secrétaire aura à écrire aux parents pour les prévenir que leur
fils, n’ayant aucune des aptitudes reconnues indispensables pour apprendre la
musique, il est inutile qu’il continue à faire partie de la Société à titre de
membre exécutant ».
Il est rappelé : « Ne pas oublier de leur demander de rendre
l’instrument et les documents (solfège et méthode) ». Nous constatons que ces exigences d’aptitudes ont
porté leurs fruits et ont permis à La Lyre, au fil des décennies, de pérenniser
son activité. C’est ainsi qu’en novembre 1954, La Lyre remettait aux musiciens
médailles et diplômes pour leurs très nombreuses années de participation : Camille
Loquineau pour 46 ans de présence à La Lyre, Marie Foissy pour 45 ans, Charles
Marteau pour 48 ans, Georges Couturier pour 45 ans, Jean Château pour 15 ans et
Gilbert Trousselet pour 15 ans.
Les femmes viennent enrichir
les ensembles musicaux
Au début de cet article, nous
parlons d’hommes et de femmes. Mais il nous faut rectifier : en réalité, et
nous le constatons en regardant les photos depuis la création de La Lyre, comme
toutes les associations de cette époque, elle est strictement composée
d’éléments masculins, et ce jusqu’en 1960 au moins.
Ce n’est que dans les années
1970, que la féminisation se généralise dans les associations, et permet aux
jeunes filles d’être acceptées et de devenir membres actifs des ensembles
musicaux. Maintenant, elles sont pratiquement en majorité !
Le document suivant est présenté
à la salle des associations où La Lyre donne ses répétitions hebdomadaires. Il
présente la liste des présidents qui se sont succédés depuis la création de La
Lyre. Complétons cette liste par Dominique Berrué, président depuis novembre
2016 et musicien. Il a succédé à Stéphane Hermelin, un autre musicien.
L’année du centenaire, La Lyre
concrétise, le 30 mars 1990, sa féminisation par la nomination de trois jeunes
femmes directrices : Nathalie Berrué, jusqu’en novembre 2020, Céline Pinon,
jusqu’en octobre 1992, et Delphine Rigny jusqu’en septembre 1998. Delphine
Doudard, qui occupe depuis novembre 2000 le poste de chef de musique, est
toujours directrice à ce jour. Aujourd’hui, l’école de musique accueille les enfants
dès la grande section de maternelle à l’éveil musical. Ils sont 12
actuellement. Puis, dès 7 ans, commence la formation musicale, plus complète
que le solfège et motivante avec la pratique d’un instrument.
L’histoire de l’association
n’a pas été exempte de conflits…
Nous évoquerons deux conflits
importants relatés par le secrétaire de La Lyre, non pas entre musiciens, mais
avec l’Église et avec les autorités municipales.
Le premier concerne le mariage
d’un musicien et le curé de l’époque : le 18 mai 1894, le chef de La Lyre
reçoit un courrier du curé Grelat de Cour-Cheverny :
« Pour son mariage le 19
mai 1894, M. Bouracé Élie demande que la musique dont il fait partie l’accompagne
à l’église. J’ai été obligé de lui dire que, puisqu’il avait choisi pour se
marier un samedi des Quatre-Temps (1), il ne m’était pas possible,
vu les lois de l’Église, d’autoriser la musique dans l’église. Cette réponse
n’a rien qui vous regarde ni votre société, M. Bailly, mais vous avez vos
règlements, l’Église a les siens, et quand malgré les observations réitérées de
son curé, on tient à se marier un jour des Quatre-Temps, il faut se résigner à
ce que le mariage religieux soit privé des solennités musicales.
En toute autre
circonstance et particulièrement pour la fête prochaine du Très Saint Sacrement,
je serai bien heureux d’avoir le joyeux concours de votre harmonie. Signé :
Grelat, curé de Cour-Cheverny.
P.S. Évidemment ce que je
dis ne regarde que l’intérieur de l’église, ce qui se passe en dehors ne me
concerne pas ».
Le chef propose de faire de la
musique pendant le mariage civil. Il est décidé de s’abstenir d’assister au
mariage religieux et de faire, à l’intention de ce mariage, de la musique au dehors.
Cependant, la plupart du Conseil n’a pas jugé à propos de déranger les
musiciens pour si peu de temps. Il est convenu qu’on s’abstiendrait d’aller au
mariage et qu’à la répétition de ce jour, on donnerait connaissance aux
musiciens de la lettre de M. le curé.
Lors de la séance du 24 mai,
les musiciens réagissent à la réponse du curé
Puisque M. le curé refuse la
présence des musiciens au mariage d’Élie Bourracé, ils s’abstiendraient de
paraître aux sorties habituelles des Fêtes-Dieu. Le surlendemain, le chef jugea
à propos de prévenir le président de ce qu’il se passait. Le 26 mai, il
recevait la réponse suivante qu’il communiqua au Conseil :
« Mon cher Bailly, Je suis
persuadé que les membres exécutants s’apercevront qu’ils sont victimes d’une
erreur en croyant que M. le curé leur refuse arbitrairement de jouer à tel jour
dans l’église, quand il leur permet de jouer à tel autre. Il ne lui appartient
pas à lui, pas plus qu’à tout autre, de modifier une règle qui est imposée
partout. La liturgie veut qu’en temps de Quatre-Temps, aucun mariage ne soit
célébré avec solennité. Pourquoi voudriez- vous qu’à Cour-Cheverny on puisse se
soustraire à cette loi, tandis qu’à Paris même où l’on donne tant de
permissions, chacun s’y soumet. Il n’y a dans cette affaire aucun mauvais
vouloir de M. le curé, qui ne fait que se conformer à la règle et je ne peux
pas croire que ces messieurs ne le comprennent pas. Aussi, j’espère que La Lyre
se fera entendre comme par le passé à la procession de la Fête- Dieu et je prie
messieurs les membres exécutants d’y apporter la meilleure bonne volonté ».
Après la lecture de cette lettre
et après mûre délibération, le Conseil de La Lyre décide que la Société sortira
comme les années précédentes et assistera aux processions de la Fête-Dieu comme
elle l’a toujours fait depuis sa création, la population du pays ne devant pas
subir le contre-coup de l’affaire Bourracé. Le chef porte à la connaissance des
musiciens la décision du Conseil. Après cette lecture, le nommé Urbain Geslain
déclare qu’irait à la sortie qui voudrait, mais que lui n’irait pas. D’autres
suivent son exemple. Le sous-chef a entendu le nommé Albert Blanchard dire
qu’il ne restait pas dans une société dirigée par le curé. Voyant les
proportions que prenait la discussion, le chef, s’appuyant sur l’article 18 qui
confie au conseil d’administration le soin de désigner les jours et heures de
sorties, affirme aux membres exécutants que la société assistera, comme tous
les ans, aux sorties des Fêtes-Dieu puisque la chose avait été décidée par le
Conseil dans la séance du 24 mai.
Devant cette résolution bien
arrêtée, neuf membres exécutants quittent la salle de répétitions : Urbain
Geslin, Albert Blanchard, Élie Bourracé, Lucien Bourracé, Gallais, Auger, Quintin,
Faivret, plus un enfant, le jeune Blanquet, qui a agi sans discernement. Aussi,
le conseil le met-il hors de cause. En voyant cette démonstration si sérieuse,
le chef juge à propos, pour la réussite de la sortie du dimanche suivant, de
rappeler les mécontents et de leur faire déposer leurs instruments et leurs gibernes,
afin de pouvoir changer l’orchestration suivant les besoins, étant donné le
nombre restreint des exécutants de bonne volonté.
Dès le lendemain, Geslin et
Blanchard font tous leurs efforts pour rallier à eux une partie des exécutants
restés fidèles à la Société en menant une campagne contre elle et surtout
contre les décisions du Conseil d’administration. Suite à cela, à la répétition
du 26 mai, il manquait, en plus de ceux nommés ci-dessus MM. Gaveau et Besnard
et, le lendemain, à la sortie, le portebannière Sausset à qui on avait dit de
ne pas se déranger, la société ne sortant pas.
Devant des faits aussi
regrettables compromettant au premier chef l’existence de la Société, le
Conseil d’administration, après avoir pris l’avis du président présent au pays ce
jour-là, décide à l’unanimité d’exclure les meneurs et de faire payer aux
autres les amendes qui leur incombent par suite de leurs absences tant aux
répétitions qu’à la sortie. En conséquence, MM. Gesclin et Blanchard sont
exclus et la lettre suivante, rédigée en séance, leur est adressée le 31 mai :
« Monsieur, Dans sa séance
d’hier soir 30 mai 1894, le Conseil d’administration de la Société musicale statuant
sur les faits regrettables qui se sont produits à propos de la sortie du dimanche
27 mai dernier, invoquant le paragraphe 2 de l’article 25 du règlement visant
le préjudice causé aux intérêts de la Société et la première partie du
paragraphe 5 du même article visant le trouble apporté aux réunions, a décidé à
l’unanimité, après l’avis favorable de Monsieur le président, de prononcer
votre exclusion temporaire de la Société. Cette exclusion sera ratifiée à la
prochaine assemblée générale conformément aux statuts de la Société. Le
conseil, suffisamment éclairé sur les faits qui ont motivé sa grave décision
n’a pas jugé à propos de vous inviter à venir les lui exposer à nouveau...
Pour le Conseil
d’administration et par son vote, Le secrétaire,
P.S. Vous êtes prié de
rendre à la société dans les plus brefs délais les objets lui appartenant desquels
vous pouvez être détenteur ».
Il est signifié que M. Bourracé,
auteur principal de cette malheureuse histoire, aurait pu l’empêcher s’il y
avait mis la moindre bonne volonté, ce qu’il aurait eu bonne grâce de faire
étant donné son peu de présence dans une Société où il a été reçu à bras
ouverts pendant près de six mois sans avoir jamais participé à aucune dépense
alors qu’il a pu, comme les autres à différentes fois, profiter des
prérogatives qui s’attachent aux Sociétés musicales comme celle de
Cour-Cheverny. Il reçoit la lettre suivante rédigée en séance, qui lui a été
adressée le lendemain :
Monsieur, Le conseil
d’administration de la société musicale dans sa séance d’hier soir 30 mai 1894 statuant
sur les faits regrettables qui se sont produits à propos de la sortie du
dimanche 27 mai dernier, en ce qui vous concerne, a décidé, après l’avis
favorable de M. le président et à l’unanimité de vous considérer comme n’ayant jamais
appartenu à la Société, se basant sur ce que vous n’avez jusqu’ici jamais
rempli les engagements que vous avez librement consentis à partir du 1er avril dernier. C'est-à-dire n’ayant payé ni votre droit d’entrée
ni votre cotisation. Pour le conseil d’administration et par son ordre, Le secrétaire,
- Messieurs Lucien Bourracé,
Faivret, Augé, Quinton qui ont quitté la répétition de jeudi 24 et celle de
samedi 26, plus la sortie du dimanche 27 auront à payer une amende de 2 francs.
- Messieurs Besnard et Gaveau,
qui se sont laissés entraîner, n’étant pas à la répétition le jeudi 24 auront à
payer pour leur absence de samedi 26 et de la sortie du 27 une amende de 1 f
50.
- M. Sausset, qui a manqué à la
sortie du dimanche ne peut être mis en cause ayant été mal renseigné.
- Pour M. Raoul Geslin, le
conseil se réserve le droit de lui demander des explications sur son absence ne
sachant pas s’il a pour l’expliquer des raisons valables ou non.
Françoise Berrué
Le second conflit eut lieu entre La Lyre et la
municipalité. Nous l’évoquerons dans le prochain numéro de La Grenouille.
Explications et
sources
(1) Les quatre temps : ces journées de jeûne ont
été instaurées dès les débuts de l’Église. Il s’agit des mercredis, vendredis
et samedis qui entament chaque saison.
- Documents extraits des
Registres des Assemblées générales de La Lyre.
- Documents : Archives
départementales, exposition “ En avant la musique”.
Article n°2 - La Grenouille n°51 - avril 2021
Suite de notre article paru dans le précédent numéro de La Grenouille.
 |
| La Lyre vers 1925 |
Le second conflit eut lieu entre La Lyre et la municipalité
Depuis sa création, les réunions et répétitions de La Lyre avaient lieu à la salle de la mairie de Cour-Cheverny. Le secrétaire de La Lyre relate ainsi ce conflit en décembre 1896. « Lors de sa création, quoique s’étant fondée en dehors de toute attache municipale, la Lyre de Cour-Cheverny avait rencontré auprès de l’ancienne municipalité l’appui le plus bienveillant pour sa formation, d’abord et ensuite par des dons en espèces, offerts spontanément à titre d’encouragement et sans aucune espèce de condition. Aussi, liée seulement par la reconnaissance, allait-elle tous les ans donner une aubade au maire et à l’adjoint. Maintenant, les choses ayant changé et le maire actuel M. Louis Mahoudeau-Maillard ayant déjà montré ses tendances à se servir et à commander la Société comme si elle était municipale ; de plus alors qu’il l’avait invitée à participer à la fête du 16 août dernier, lors de la venue de M. le préfet dans la commune, et plus tard le 6 décembre à la fête de Sainte Barbe ayant montré un sans façon et un manque d’égard flagrant vis-à-vis d’elle, le Conseil
 |
| La Lyre en 1947 |
En conséquence, pour éviter tout froissement et malgré le précédent établi qui lui dicte des devoirs à remplir, la Société se bornera, à l’avenir, à rendre tous les ans, seulement une seule visite : celle à M. le président ».
27 décembre 1896
Lors de la réunion, La Lyre
doit régler les visites que la Société musicale aura à faire à l’avenir pour le
Nouvel An. Le Conseil de La Lyre, réuni au complet et assisté des membres
honoraires, desquels le concours bienveillant est acquis depuis la création de la
société, est saisi de la situation difficile que va créer à la société, à
propos des visites que celle-ci a coutume de faire au jour du Nouvel An, le
changement qui s’est produit dans la municipalité. C’est la dernière réunion
qui aura lieu en la salle des séances à la mairie de Cour-Cheverny.
27
février 1897
La réunion suivante a lieu chez le secrétaire.
L’ordre du jour
prévoit de renseigner le Conseil de La Lyre sur les agissements de la
municipalité depuis le 27 décembre dernier : les membres actifs du bureau et du
Conseil portent à la connaissance de celui-ci que le maire, Louis
Mahoudeau-Maillard, par une lettre datée du 3 janvier dernier, a donné ordre au
chef de La Lyre de déménager les halles (la mairie actuelle) dans le délai de
huit jours. Le lendemain, quelques musiciens se sont mis à l’oeuvre et ont
enlevé le matériel restant à l’endroit désigné. Ce travail fini, le chef s’est présenté
à la mairie et a prévenu le maire qu’il allait, avec son autorisation,
déménager le matériel de la Société déposé dans la grande salle du 1er
 |
| La Lyre le 2 août 1959 |
La Société étant préparée et l’arrêté n’ayant pas encore été signifié à la Société, le chef demande à sortir avant. Le Conseil est d’avis qu’il le fasse seulement pour éviter tout ennui, il devra demander l’autorisation au maire. Demain étant un dimanche, on sortira si l’autorisation est accordée.
Le président de La Lyre demande au trésorier quelques renseignements sur l’état actuel de la caisse, en raison de ce que la Société va se trouver dans la nécessité de dépenser pour subvenir aux frais d’une installation nouvelle qui lui permettra à la fois de faire des réunions et de loger son matériel. Le trésorier ne peut donner les chiffres exacts avant l’assemblée générale, mais cependant, il peut affirmer que l’encaisse permettra d’engager les frais nécessaires, quand le moment sera jugé opportun.
 |
| La Lyre vers 1971 |
7
mars 1897
M. Legout (café-restaurant), met à disposition sa salle pour La
Lyre, qui tient ce jour-là son assemblée générale. Le président regrette l’absence
des membres honoraires en raison des choses importantes à traiter concernant la
situation actuelle de la Société.
Il remercie M. Legout pour la mise à disposition
de la société de sa salle de danse, en attendant de trouver un local pour ses
réunions et répétitions. Il engage beaucoup ceux des membres honoraires ou
exécutants que le nouvel état de chose gênerait, à démissionner de suite, pour
éviter, dans la suite, des désertions désastreuses pour la Société. Il dit
qu’il vaut mieux se compter de suite et savoir comment s’organiser pour
continuer à marcher de l’avant. Les sociétaires mis aussi en demeure, semblent
tous être acquis quand même à la Société car aucun ne donne sa démission.
Le
président porte à la connaissance de l’Assemblée que les membres du bureau, et
particulièrement le chef de musique, ont agi récemment auprès du maire pour
rentrer en possession des instruments, partitions et matériels que celui-ci
retient à la mairie. Opposant toujours à ses demandes un refus persistant, il a
récemment déclaré qu’il voulait, pour finir le règlement de cette affaire, voir
le président et s’entendre avec lui, à l’exclusion de tout autre. Quoique ne
sachant où le maire veut en venir et se demandant quelles peuvent bien être les
conditions qu’il semble vouloir imposer, le président assure à la Société qu’il
prendra jour, si c’est possible, avec le maire, et qu’il prend à sa charge
personnellement les moyens de régler le différend, celui-ci devraitil se régler
pécuniairement, ce qu’il croit du reste, et en cela, il a la majorité de
l’assemblée de son avis, sinon l’unanimité.
Le président, prié par quelques
membres du Conseil d’administration de donner quelques renseignements sur la
marche du différend entre la société et la municipalité, dit que l’affaire a
maintenant une solution. Le maire ayant exigé le remboursement d’une somme de
500 F. donnée quelques années avant à l’unanimité, par le conseil municipal, pour
encouragements à la société et la remise de quelques anciens instruments
appartenant à la commune ainsi qu’une somme (illisible) provenant de débris
d’instruments, d’anciens instruments vendus par M. Bailly d’après les instructions
de l’ancien maire M. Bonamy. Le Président a déjà remboursé de ses propres deniers
les 500 F demandés, il restera aux membres du bureau à remettre de suite les
instruments demandés (lesquels viennent d’être remis à neuf par les soins et
aux frais de la Société) et la somme qui a été encaissée par la société. M. Le
Président exprime le désir que ces remises se fassent au plus tôt et que la
société se débarrasse de suite de cette affaire qui déjà a trop longtemps duré étant
donné le mauvais vouloir du maire et de la municipalité.
 |
| La Lyre en 1973 (premier calendrier) |
le 11 avril, sans raison apparente et sans explication, Jules Gaveau a démissionné verbalement. À la suite de la répétition du 14 avril, Blanchard a démissionné verbalement sans donner d’explication quoiqu’il ait été invité à le faire par les membres du bureau et du Conseil présents à la répétition. Borde avait laissé, sans plus s’en occuper, des instruments à Contres le jour du festival à la fin de la soirée, qui ont été rapportés par les soins du chef. Depuis, il n’est jamais reparu à la Société, et n’a pas envoyé de démission. Le Conseil décide que les parents étant responsables de leurs enfants mineurs, il y aura lieu de leur rappeler par lettre recommandée les articles du règlement concernant leurs cas et de s’y conformer. Il leur sera donné jusqu’au 23 mai pour donner leur réponse.
À propos des affaires Gaveau, Borde et Blanchard, les lettres ont été refusées et sont revenues. Le Conseil demande au chef s’il y a lieu d’essayer à faire rentrer ces jeunes à la Société, jugeant préférable de faire le possible pour les y garder plutôt que de recourir aux moyens extrêmes. Les membres exécutants consultés par le chef déclarent à l’unanimité qu’en raison de leur mauvaise tenue dans toutes les sorties ou réunions et des preuves d’indiscipline qu’ils donnent trop fréquemment, la meilleure solution est de les exclure tous les trois de la société. Ce qui fut fait.
 |
| 1973 |
Ces deux exemples de conflits nous montrent la rigueur que la société musicale entend maintenir dans ses rangs, et le reflet de la rigueur draconienne des premiers statuts des ensembles musicaux. Les sanctions étaient dissuasives. Rappelons que dès sa création, les objectifs de La Lyre étaient de participer à des concours au niveau national, ce qui .explique les exigences...
Françoise Berrué
- Documents Extraits des Registres des Assemblées générales de La Lyre. Documents
: Archives départementales, exposition « En avant la musique ».
- Crédit photo :
Archives de La Lyre.
 |
| Centenaire de l'école de Cheverny (1983) |

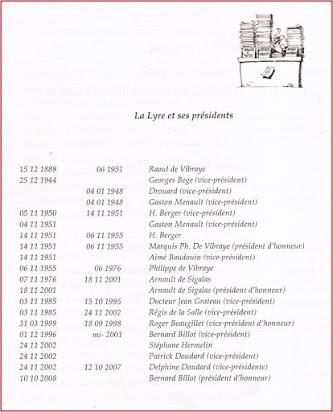


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Merci de nous donner votre avis sur cet article, de nous transmettre un complément d'information ou de nous suggérer une correction à y apporter