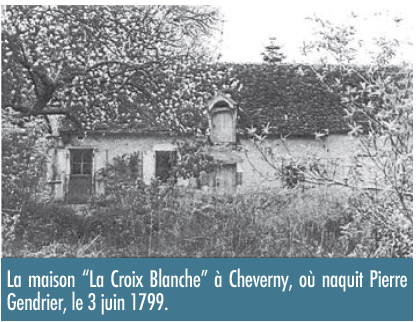La famille Dronne à Cheverny et Cour-Cheverny
Commémorations et souvenirs
Sources : Wikipédia et www.chambord.org/fr
La Grenouille n°68 - juillet 2025
La vie de Château à Cour-Cheverny
Peinture à Cheverny
En visitant le château de Cheverny, on est toujours admiratif devant la qualité des décors et notamment des peintures, dans un état remarquable… Damien, Chevernois, nous a transmis le témoignage de son grand-père, qui lui a évoqué le souvenir de son métier de peintre oeuvrant autrefois au Château de Cheverny, artisan de cette qualité qui ne date pas d’hier…
D’abord au château de Ménars…
Guy Bleau est né en 1931 dans le hameau de Fleury sur la commune de Suèvres, d’un père cantonnier et cultivateur, et d’une mère qui tenait un café. En 1945, Guy, alors âgé de 14 ans, travaille en apprentissage comme peintre en bâtiment chez M. Gagnepain à Ménars, ami de ses parents.
La première année, il intervient comme peintre-vitrier au château de Ménars alors propriété de Saint-Gobain. Durant les années précédentes, les Allemands avaient repeint une bonne partie des pièces en gris et les plafonds en blanc, et brisé une multitude de carreaux aux fenêtres.
Perché à plusieurs mètres de hauteur sur son échelle double, assis en équilibre sur les barreaux, Guy retirera difficilement la peinture appliquée par les Allemands, avant de pouvoir étendre une nouvelle peinture. Il restaurera également les fenêtres ainsi que les parois d’une serre, allant chercher les verres à l’aide d’un diable à la gare de Ménars, en provenance des usines Saint-Gobain. Et Guy se souvient que c’est sur ce chantier qu’il en a le plus bavé.
…puis au château de
Cheverny
Suite à une altercation
avec son patron qui l’avait injustement sanctionné, Guy quitte l’entreprise un
vendredi soir, avec quelques difficultés pour récupérer ce qui lui était dû, et
est embauché dès le lundi chez Robert Janvier, peintre à Blois. M. et Mme
Janvier habitaient rue Chambourdin, dans une maison où était entreposé tout le
matériel de l’entreprise, et où était installé le salon de coiffure de Madame.
Guy réalisera de
nombreux travaux de peinture à l’intérieur du château, sur des murs, des boiseries,
des plinthes. Il réparera également, avec son patron, des tables, des chaises
et des fauteuils.
Tous deux allaient aussi repeindre de grands panneaux en bois indiquant « Visitez le château de Cheverny », qu’on pouvait voir sur les murs et sur les routes de tout le département. Certains, abimés par le soleil, nécessitaient une restauration complète, d’autres, en tôle galvanisée, avaient besoin d’un simple nettoyage à l’eau.
Le marquis de Vibraye les avait autorisés à s’installer dans un des box de la partie droite des écuries qui ne recevait plus de chevaux. Un jour d’hiver, Guy et ses collègues déjeunaient sur une table installée au fond de l’ancien box converti en atelier. Le marquis, entendant des voix, fait irruption dans l’atelier : « C’est ici que vous mangez ? Vous avez froid ! Je m’occupe de vous ». Il revient une trentaine de minutes plus tard et leur dit « À partir de maintenant vous demanderez au concierge, il vous expliquera, vous irez manger là-bas et il vous fera du feu le midi ». Après que le gardien eut remis en état la pièce présente sur la partie gauche des écuries, elle devint leur pièce de vie et ils purent ainsi manger au chaud.
Un jour de pluie, Robert Janvier s’adresse à ses ouvriers : « Vous voyez le temps qu’il fait, vous savez ce qu’il faut que l’on fasse... ». Ils durent repeindre toutes les sous-faces en bois du bâtiment des écuries, dépassant de 40 cm environ et s’étalant sur plus de 500 m de long…. Ils y apposèrent trois couches de couleur brun Van Dick (rouge sang foncé) et le travail devait être terminé en une semaine, avant une date précise. Pendant tout ce temps, il tombait de l’eau à ne plus jamais s’arrêter. Le patron leur avait acheté un semblant de veste imperméable qui ne leur servit pas à grand-chose car les toits n’ayant pas de gouttières, l’eau dévalait la toiture et se jetait sur eux ; ils en prenaient plein la figure et les bras, tandis qu’ils peignaient les dessous de toits qui eux étaient au sec…
Toujours bien traités Très souvent, à la suite d’une partie de
chasse à courre ou d’une vidange d’étang, le marquis venait retrouver Guy pour
lui dire : « Monsieur le Peintre ! Vous passerez voir le concierge avant de
partir ». Ce à quoi Guy répondait « Oui, oui, c’est d’accord Monsieur le
Marquis ». Cela indiquait qu’il leur avait mis de côté un demi-sac de viande
(biche ou cerf) ou de poisson, coupé et vidé. Et Guy de préciser : « Si tu
étais là, tu étais sûr de partir le soir avec quelque chose ».
Le village à une autre
époque…
De l’autre côté de la route, se trouvait aussi un café-restaurant (aujourd’hui « Le Pinocchio ») ; il était ouvert le midi pour les ouvriers et tenu par une femme prénommée Marie et sa fille. Si la mère de Guy n’avait pas eu le temps de lui préparer à manger, il passait au café-restaurant le matin et demandait à Marie de lui préparer quelque chose pour le midi. Il mangeait avec elles et non dans la salle avec les autres ouvriers.
Guy a eu connaissance de la présence d’abris en bois recouverts de toits en tôle ou en ardoises sur le parking du château, où était amené le bois du parc afin de le transformer en charbon pour les gazogènes ; cela servait de carburant alternatif pour les véhicules car l’essence se faisait rare durant la guerre. Après-guerre, une fois qu’il y eut assez d’essence, les installations furent démolies
Le transport…
Un matin, le patron
déposa Guy et Jojo à Cheverny, avant de prendre la route pour Orléans. Guy et
Jojo travaillèrent toute la journée puis attendirent vainement leur patron de 18
h à 19 h pour le retour.
Ne le voyant pas
arriver, ils prirent à pied le chemin de Blois ; après 15 minutes de marche, ils
arrivent sur la place de l’église de Cour- Cheverny. Le patron des Trois
Marchands, M. Bricault, chez qui ils mangeaient certains midis et pour qui ils
ont travaillé longtemps dans les chambres et les salles de déjeuner, était un grand
ami de leur patron. En les apercevant, il leur demande où ils allaient ainsi à
pied et leur propose de les emmener, mais Jojo refuse. Et c’est ainsi que les
deux sportifs arrivèrent à Blois après 3 h 30 de marche sur 15 km...
Lorsque Guy arrive chez
son patron pour prendre son vélo et rentrer chez lui à Suèvres, celui-ci
s’aperçoit qu’il a oublié d’aller les chercher et leur demande comment ils ont
fait… Guy lui explique qu’ils sont revenus à pied… « M. Bricault a proposé
de nous emmener, mais Jojo a refusé ! ». « Ça ne m’étonne pas de celui-là » lui
répondit Robert Janvier.
Le lendemain matin, Guy
arrive au travail et son patron lui dit : « J’emmène les gars à Cheverny et
je reviens, tu m’attends ». Lorsqu’il revient, il s’adresse à Guy : «
Monte dans la bagnole, on s’en va chez le marchand de vin ». Situé au 8 rue
de la Garenne, Marcel Berruet est un ami de son patron et quand ils arrivent,
seul sa femme est présente. Janvier lui dit : « On vient pour ma bagnole ».
Elle les emmène dans une grange, là où se trouve dans le fond l’automobile de
Robert Janvier, une belle Hotchkiss noire, rangée là car elle ne servait pas.
Une fois sortie, nettoyée puis arrangée par un mécanicien, elle devint ainsi le
moyen de transport des ouvriers pour se rendre à Cheverny sans encombre ! Un
beau véhicule de service !
Les amis…
D’après Guy, une partie
des salariés qui travaillaient dans le château étaient logés à côté du
cimetière de Cour-Cheverny. Guy se souvient également des copains ouvriers
maçons, menuisiers, etc., qu’il a pu côtoyer, et des frères Ducolombier, dont
plusieurs travaillaient au château, et d’un plus jeune qui était peintre à
Cour-Cheverny et qu’il retrouva quelques années plus tard dans son équipe à
Blois.
L’ambiance était bonne…
Un jour au château, une
guide en pleine visite explique : « C’est un tableau d’époque Louis XV ».
Guy, qui travaillait à côté avec un collègue, ne put s’empêcher de murmurer «
Menteuse, ce n’est pas vrai, il est du XV e », ne pensant pas être entendu
; après la visite, la guide vint à leur rencontre leur dire d’un ton amusé : «
Vous savez que l’on entendait toutes vos âneries et que tous les visiteurs rigolaient,
j’aurais pu louper ma visite ! ».
Un autre jour, une porte
séparant deux pièces était ouverte, d’un côté Guy, de l’autre une guide qui
conte à ses visiteurs : « C’est un fauteuil d’origine qui n’a jamais été
réparé », et Guy de commenter : « Ça fait 15 jours que je l’ai réparé ».
Car Guy et son patron ont tous deux oeuvré parfois à la restauration de certaines
chaises et fauteuils en bois. Les chaises étaient peintes d’une couleur gris
clair avec des filets de dorure, mais si elles étaient cassées ou abimées,
c’était au menuisier de s’en charger.
Et les accidents…
Lors d’une période de
froid, Guy accompagné de deux collègues travaillaient sur un pavillon en forêt
de Cheverny qu’ils mettaient à neuf intérieurement et extérieurement, dans le
but de pouvoir y accueillir un garde. Gilbert, ouvrier peintre, voyant du bois
et des brindilles bien sèches dans le large four à pain de la demeure, décide
d’y faire une petite flambée. D’après Guy : « Le four était tellement large
que l’on aurait pu y faire cuire un chevreuil entier ».
Mais tout ne se déroula
pas comme prévu, car le bois, bourré à bloc, très sec du fait de sa présence
ici depuis 10 ou 15 ans, flamba très vite et provoqua un début d’incendie. Fort
heureusement, un puits se trouvait à proximité, Guy y tira des seaux d’eau en
vitesse pour les passer à Gilbert et Jojo, qui attaquèrent les flammes. C’est
en venant les chercher le soir que leur patron, interrogé par la fumée qu’il
aperçut au loin se dit qu’il y avait quelque chose d’anormal. À son arrivée,
voyant la situation, il les aida avant de leur dire : « Si il était resté
des armes et munitions cachées là pendant la guerre par des FFI [Résistants,
nombreux à se cacher en forêt] tout aurait explosé ! ». Plus de peur que
de mal !...
Autres emplois…
Quelques temps plus
tard, son patron, ayant perdu un gros chantier, doit se séparer d’un ouvrier.
Guy laisse sa place à son collègue Gilbert, indiquant qu’il est nécessaire pour
lui de garder son emploi pour subvenir aux besoins de sa fille handicapée : «
Si je m’en vais, demain matin, j’attaque ailleurs, y’a un patron qui m’attend
».
Après sa mobilisation en
Algérie, Guy travaille quelques temps en région parisienne puis s’installe à
Blois après son mariage. Il est embauché par la ville comme responsable d’une
équipe technique. Il réalise une multitude de travaux dont des faux marbres à
la mairie, des décors à la Halle-aux-grains, des faux-bois sur les portes des
écoles, mais aussi les fleurs de lys de la grande salle des États généraux du
château de Blois. Il réalisera plusieurs peintures artistiques dont certaines
furent longtemps exposées à la mairie de Blois. Il a aussi refait la totalité
de la peinture du château des Forges à Suèvres entre les années 70 et 80.
De beaux souvenirs
Guy, aujourd’hui âgé de
94 ans, est un puits de souvenirs et d’anecdotes en tout genre… C’était un
grand sportif, footballeur et cycliste à Suèves avant de rejoindre l’AAJB
(Association Amicale de la Jeunesse Blésoise). Il garde encore un très bon
souvenir du Château de Cheverny, des bons moments passés, des bons copains ; il
se souvient que lui et ses collègues étaient bien payés et n’avaient pas besoin
de courir pour que le travail soit bien fait, et il nous décrit le marquis Philippe
Hurault de Vibraye et son épouse comme des personnes « remarquables,
gentilles, altruistes et très agréables ».
P. L.
La Grenouille n°68 - juillet 2025
Eugénie née Gendrier, à la Petite Bourdonnière
Eugénie, née le 6 juillet 1874, avait reçu une belle instruction dans une famille courageuse et âpre au gain. Son ambition et sa rigueur au travail la prédisposaient à réussir sa vie. Sa vie de femme, elle la commença avec son mari François Chéry comme fermière à La Borde jusqu’en 1914. Elle avait alors 40 ans. Il est remarquable que ce couple, en 24 ans (Eugénie est décédée en 1938) a, à force de travail, pu acheter quatre fermes autour de La Borde. La première, La Champinière en 1907 ; ensuite La petite Champinière (les bâtiments ont aujourd’hui disparu), puis La Closerie du Pont, et La Guillonnière, sur la route de Tour-en-Sologne. À cela s’ajoute la maison familiale à Cheverny (La Petite Bourdonnière), avec ses vignes et ses champs de céréales.
Merci à Hélène Bidault-Rutard, qui nous fait profiter des fruits de
ses recherches afin de porter à la connaissance des lecteurs de La Grenouille
l’histoire des familles Gendrier- Chéry, ses ancêtres, qui se sont implantés de
longue date sur les communes de Cheverny et de Cour-Cheverny.
Merci à Pierrette Cazin et à Alain Chéry pour leurs témoignages.
(1) Furet : Sorte de fumigateur à poudre à usage manuel, employé
autrefois par les vignerons pour chasser des vignes les insectes volants et
rampants.
(2) Pyrèthre : L’extrait de pyrèthre végétal, plante herbacée apparentée
au chrysanthème, agit par contact avec un effet choc contre les insectes
volants et rampants.
Le matin du 21 août 1944, un convoi allemand venant de Cour- Cheverny se dirige vers Blois. En traversant la forêt, il est attaqué par un groupe de maquisards, très inférieur en nombre, qui se retire rapidement. La colonne allemande contourne alors la forêt et se dirige vers Mont-près-Chambord. Elle incendie des maisons et massacre les habitants. Puis la colonne se dirige vers Huisseau, Chambord, La-Ferté-Saint-Cyr. On déplorera 31 victimes pour cette seule journée.
Le docteur Jean Grateau était à l’époque jeune médecin établi à Cour-Cheverny. Il était venu procéder à un accouchement à Montprès- Chambord. Au retour, sur son vélo, il croisa un groupe de FFI à proximité du lieudit « Le Plein », fermes de la famille Martineau-Chéry. Les FFI se mettaient en position pour attendre la colonne d’Allemands qui se dirigeait vers le bourg. Le docteur les mit en garde en vain sur le fait que les Allemands étaient beaucoup mieux armés, plus nombreux, et prêts à des représailles sur la population en cas d’attaque. La suite fut dramatique... Peut-être rien n’aurait-il changé en renonçant à l’attaque car on ignorait les intentions des Allemands.
Propos recueillis par Pierrette Cazin
Témoignage de Rolande Chéry
Lundi 21 août 1944. Début de matinée, très humide, coup de feu vers
9 heures. Nous sortons dehors et nous apercevons une rangée de militaires
allemands fusils braqués tout le long du fil utilisé par le cordier du village.
Nous sommes rentrés et nous avons entendu des coups de feu toute la matinée.
À notre porte, il y avait des pommiers et divers matériels
agricoles, les Allemands avaient installé là une cuisine, la Croix Rouge et une
petite mitrailleuse et un autre engin de ce genre. C’était l’heure du repas et
un officier allemand est entré chez nous révolver au poing pour demander du
poivre que nous n’avions pas, il a tiré deux coups de feu dans la cuisine où
nous étions tous, ma mère, mon petit frère de six ans, une petite fille de 13
ans venue chercher du lait, et moi-même.
Une balle s’est logée dans la patte de la table, l’autre a atteint
le chien. Heureusement les deux hommes présents, Louis Martineau et Jean
Mauguin, 16 ans, qui travaillaient chez nous, ont sauté par une fenêtre et ont
couru (très vite) à travers les balles vers la forêt. Par chance personne n’a
été blessé.
Après avoir cru entendre leur départ, nous sommes sortis prudemment et
avons aperçu ma tante (madame Amiot) les bras au ciel. Ils ont tué Raymond et
Daniel (ses deux fils) et mis le feu avec une bombe incendiaire a un de ses
bâtiments et à celui de leur voisine ; tout fut perdu. Une autre voisine
(madame Morin) est là. Passe Pierre Daridan auquel elle apprend que les
Allemands ont tué ses deux frères (Roland et Maurice) et sa mère. Le pauvre
repart en titubant, mais il n’a pas le temps d’aller bien loin, il rencontre
George Morin, et là, face aux Allemands, on devine la suite ...
Je le revoie et l’entend toujours; ils furent tués tous les deux
dans les minutes suivantes, je ne l’ai pas vu, mais entendu deux coups secs qui
restent à jamais gravés dans mes oreilles. Après un moment, je suis sortie dans
la cour et à la vue des deux corps allongés, j’ai fait demi-tour.
Le lendemain, très pénible, Louis Mauguin est venu, très mal en point
ayant perdu sa femme, ses trois enfants et un ami, monsieur Mérillon. C’était
très pénible, tout le monde était très compatissant à ces drames et
impuissant...
Le jour des obsèques, je gardais mon petit frère et ma cousine de cinq
ans dont le père Raymond Amiot et l’oncle avaient été tués, avec une grande
angoisse car la peur était là, surtout celle de voir revenir les soldats ...
Je suis la seule survivante capable de me souvenir de ces maudits moments
et ces tristes souvenirs restent gravés dans ma mémoire comme pour tous ceux
qui les ont vécus.
Ce témoignage fut donné à Pierrette Cazin peu avant le décès de
Rolande Chéry. C’est à force de pugnacité qu’elle l’obtint car les événements
dramatiques relatés eurent lieu dans la maison natale de Pierrette.
L’acte de bravoure de Louis Martineau
Dans sa lettre, Rolande explique que les deux jeunes de 16 ans qui travaillaient
à la ferme, Louis Martineau et Jean Mauguin, échappèrent aux allemands en
sautant par la fenêtre. Ils réussirent à échapper aux balles en courant à
travers les vignes situées derrière la ferme et se réfugièrent dans la forêt.
L’action remarquable de Louis Martineau fut de sauter sur un vélo
trouvé à l’extrémité d’un rang de vigne et d’aller prévenir la population de Mont-près-Chambord
qui était en train de décorer leur village avec des pancartes sur lesquelles on
pouvait lire : « Mont libéré ! ». Il parcourut le bourg pour prévenir la
population de retirer toutes les pancartes et de se cacher en criant : « Les
boches tuent tout le monde ! ». Lorsque la colonne allemande traversa le
bourg, il était désert... De ce fait, il n’y eut pas d’autres victimes.
Louis rentra à travers champs et par la forêt pour retrouver son copain
Jean Mauguin. Il découvrit alors l’ampleur de la tragédie qui avait eu lieu un
peu plus tôt...
Propos recueillis par Pierrette Cazin
La Grenouille n°67 - Avril 2025